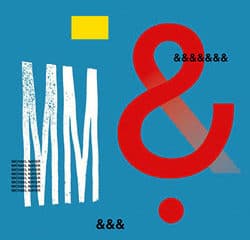électro
Rencontre avec le djay grenoblois Kiko
Alone in the dark

La montagne, ça vous gagne. En tout cas dans le monde de l’électro. Ou disons plutôt que Grenoble est depuis longtemps un vivier de grands noms de la scène électronique française. Miss Kittin, The Hacker, Oxia et… Kiko. Ce dernier n’est certes pas le plus connu, mais tous les montagnards vous le diront, ce ne sont pas les sommets les plus imposants, qui révèlent les plus beaux paysages. Dans l’ombre de ces « montagnes », donc, Kiko suit son sentier, parfois un peu tortueux, et sort aujourd’hui du bois avec un deuxième album, « Slave Of My Mind ». De la house minimal ? De l’électro-clash ? De la new wave des temps modernes ? Un peu tout ça à la fois…

Kiko, ça faisait presque cinq ans que tu ne nous avais plus donné de nouvelles. Que s’est-il passé ?
J’ai continué à faire de la musique, mais j’ai un peu calmé le jeu sur les soirées. Non pas que j’en ai eu marre, mais je voulais plus me concentrer sur le travail en studio. Je n’ai fait quasiment que de la production. Fin 2006, j’ai envoyé quelques morceaux chez Pias. Ils ont adoré et ils m’ont demande de faire un album. Alors je me suis remis au travail.
Et pourquoi cette envie de studio ? Est-ce à dire qu’un djay, arrivé à un certain âge, à plutôt envie de s’exprimer sur album, que sur le dance-floor ?
C’est clair ! On s’assagit, je pense, avec l’âge. Et puis on a plus de vécu aussi, alors on a plus d’émotions à partager, plus de choses à dire, notre musique est plus aboutie. En tout cas, pour ma part, c’est venu naturellement. J’avais envie de produire des morceaux, de donner un peu de moi. Je me suis d’ailleurs amusé à compter, l’autre jour, je crois que j’ai sorti plus de 200 titres, ces quatre dernières années.

Tout à fait. J’ai eu une vie assez difficile ces dernières années, je le reconnais, j’ai perdu pas mal de proches. Donc logiquement j’ai mis plus d’émotion dans mes morceaux, j’ai essayé de faire passer et de faire ressentir plus de choses.
Comment tu t’y prends, pour transmettre des émotions ? En électro, on ne peut pas parler de chanson, il n’y a pas de textes ?
Tout passe par la manière de construire le morceau, en fait. C’est vrai qu’à première vue, l’électro a un côté festif, mais surtout l’électro minimale, à mon avis. Chez moi, la plupart des titres sont très mélodiques. Et là où il y a de la mélodie, il y a de l’émotion. Le langage n’est pas forcément universel, certains ne ressentiront rien, mais certaines personnes me disent, par contre, qu’ils ont senti quelque chose de particulier. Il y a des gens qui vont même jusqu’à dire que mes titres sont dark, un peu comme la new wave. Nous, avec The Hacker, on ne trouve pas ça sombre, on trouve ça juste joli.
« Slave Of My Mind ». Ce titre signifie-t-il que tu avais tellement de choses à exprimer, que tu es devenu, en composant, l’esclave de ton esprit ?
Bien-sûr. Et surtout, au lieu d’aller voir un psy, je suis allé en studio. C’est réellement de cette manière que ça s’est passé. J’ai ressenti le besoin de faire de la musique, composer m’a aidé à m’en sortir, véritablement. Je suis allé travailler mes morceaux tous les jours, j’ai tout mis ce que j’avais en moi, dedans. Cet album m’a aidé à m’exprimer, c’est une thérapie musicale.
L’album « Midnight Magic », en 2001, allait à contre-courant de ce qui se faisait à l’époque, avec des sons très italo-dance, très années 80, alors que tout le monde ne jurait que par les samples funky des années 70. Pourquoi ?

Tu aurais pu choisir la facilité en sortant un album dans cette lignée, aujourd’hui. Mais « Slave Of My Mind » sonne différent. Différent dans le son et dans la fabrication, aussi ?
Exactement. D’un point de vue technique, déjà. « Midnight Magic » je l’ai fait avec un Atari et des samplers. Il y a énormément de samples, mis bout à bout. « Slave Of My Mind », lui, a été produit uniquement sur ordinateur avec différents logiciels et j’ai tout créé de A à Z, il n’y a aucun sample. Et puis mes précédents albums ont plutôt été faits dans l’urgence, là j’ai pris le temps de travailler chaque morceau, un à un. Ce sera d’ailleurs un album sans doute plus difficile à jouer en live.
Justement, par rapport au live, tu prépares beaucoup de choses en amont pour te laisser plus de liberté en soirée, ou au contraire, tu t’appliques à tout rejouer pour plus d’authenticité ?
Avec « Slave Of My Mind », il y a certains morceaux que je ne peux pas faire du tout, parce que trop lents, ou trop chantés. Pour les autres, je ne veux pas tout refaire en live. Mais je ne prépare pas non plus trop de choses à l’avance, j’aime bien garder une part d’improvisation. Il faut pouvoir réagir en fonction du dance-floor.
crédit photo : © Audrey Laurent

-
pop-rock2 semaines avant
Billetterie Paléo 2025
-
rap-rnb5 jours avant
Rural GRAFF Festival : Quand le Street Art investit la campagne
-
Scène française2 semaines avant
Michel Polnareff tire sa révérence avec « Ma dernière tournée »
-
rap-rnb3 semaines avant
John Legend à l’Accor Arena de Paris pour les 20 ans de « Get Lifted »
-
Scène française1 semaine avant
Saez « Apocalypse » : L’odyssée d’un poète révolté
-
pop-rock2 semaines avant
Lady Gaga en concert à Lyon et Paris en 2025
-
pop-rock3 semaines avant
Programme Paléo 2025
-
pop-rock3 semaines avant
Elton John et Brandi Carlile unissent leurs talents sur l’album « Who Believes In Angels? »